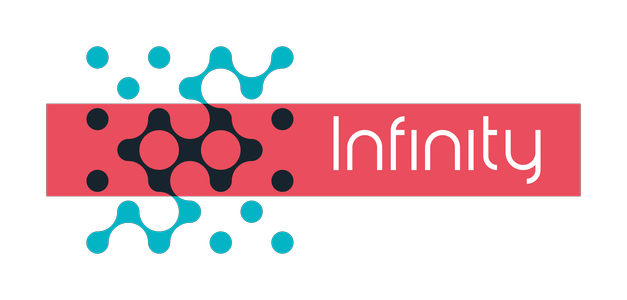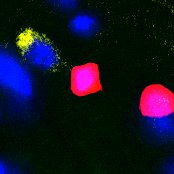Auteurs: Fanny Martinez, Coline Cotineau, Julien Novarino, Cyrielle Bories, Louis Culie, ,Stephane Rodriguez, Corine Pérals, Simon Lachambre, Valérie Duplan-Eche,Florence Bucciarelli, Béatrice Pignolet, Roland S. Liblau, Laure Michel, Meryem Aloulou*#, Nicolas Fazilleau*#
La dérégulation des processus immunitaires au sein du système nerveux central conduit à une neuroinflammation, phénomène pathologique majeur dans la sclérose en plaques (SEP) et d’autres maladies auto-immunes. Si l’interaction fonctionnelle entre lymphocytes T et B dans la SEP est bien documentée, le rôle exact des lymphocytes T régulateurs folliculaires (Tfr) dans ces mécanismes demeurait incertain. Ces cellules sont classiquement décrites comme des modulateurs de la réponse immunitaire dans les organes lymphoïdes secondaires, limitant la production excessive d’anticorps. Toutefois, leur fonction, protectrice ou délétère, dans le contexte neuro-inflammatoire restait une question ouverte.
Des travaux menés à l’Institut Infinity (Toulouse Institute for Infectious and Inflammatory Diseases) démontrent désormais que, contrairement à l’hypothèse initiale, les cellules Tfr peuvent en réalité exacerber la neuroinflammation auto-immune. L’analyse de cohortes de patients atteints de SEP révèle une augmentation des cellules Tfr circulantes en phase de rechute par rapport aux phases de rémission. Parallèlement, dans des modèles expérimentaux d’encéphalomyélite auto-immune (EAE), l’absence de cellules Tfr s’accompagne d’une réduction de la sévérité clinique, associée à une moindre infiltration de lymphocytes B dans le parenchyme cérébral et à une activité pro-inflammatoire atténuée des lymphocytes T.
L’étude met en évidence un mécanisme moléculaire central. En l’absence de cellules Tfr, les lymphocytes B présentent une expression accrue du récepteur S1PR2, favorisant leur rétention dans les centres germinatifs des ganglions lymphatiques. En condition physiologique, les cellules Tfr apparaissent ainsi faciliter la sortie des lymphocytes B activés, leur migration vers le système nerveux central, et la réactivation de lymphocytes T encéphalitogènes, contribuant aux rechutes de la maladie.
Ces résultats apportent un éclairage inédit sur la pathogenèse de la SEP. Loin de se limiter à une fonction suppressive, les cellules Tfr participent activement à la dynamique neuro-inflammatoire. Leur quantification sanguine pourrait constituer un biomarqueur pertinent de l’activité pathologique et leur modulation représenter une voie thérapeutique innovante.
Ce travail, publié dans la revue Science Translational Medicine, a été dirigé par Meryem Aloulou et Nicolas Fazilleau, en collaboration avec des neurologues.
Lien vers l’article https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.ady1268